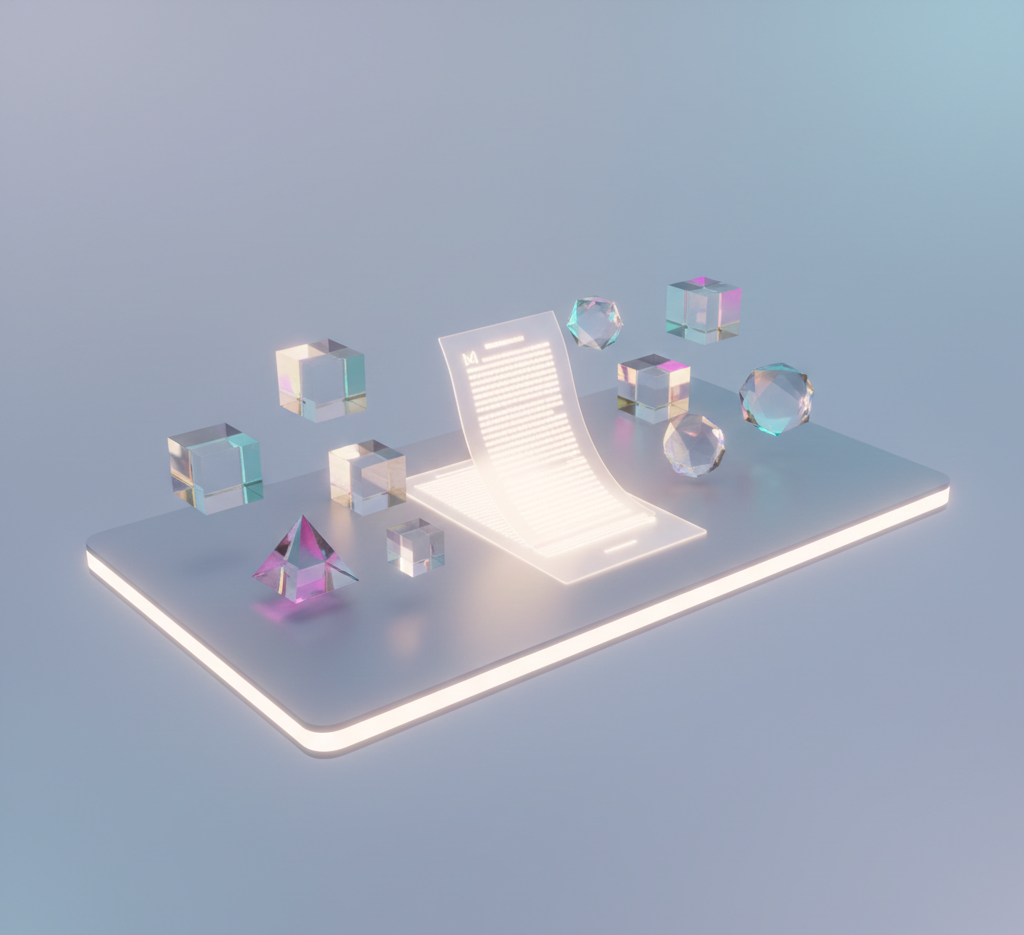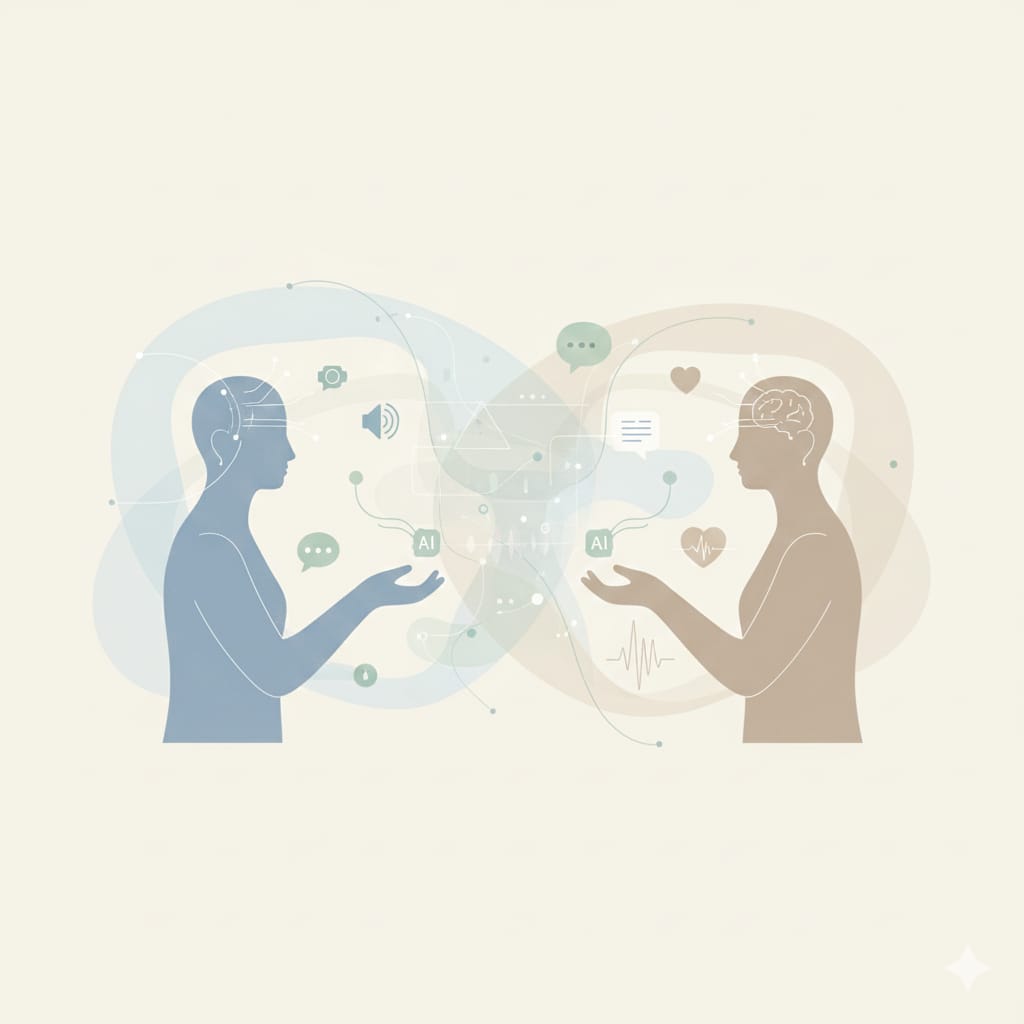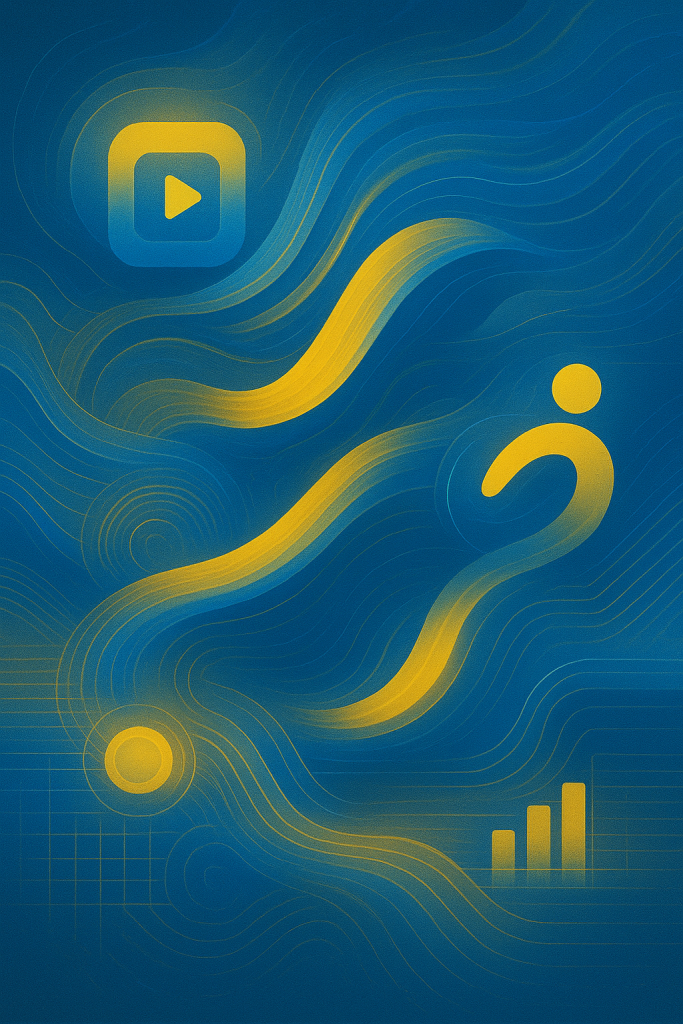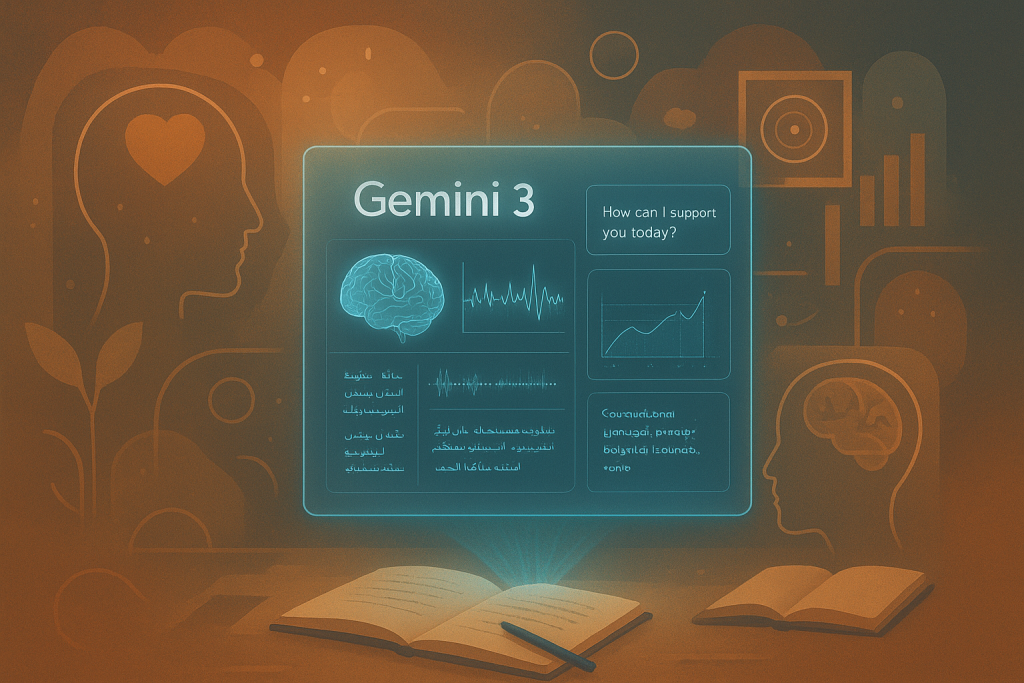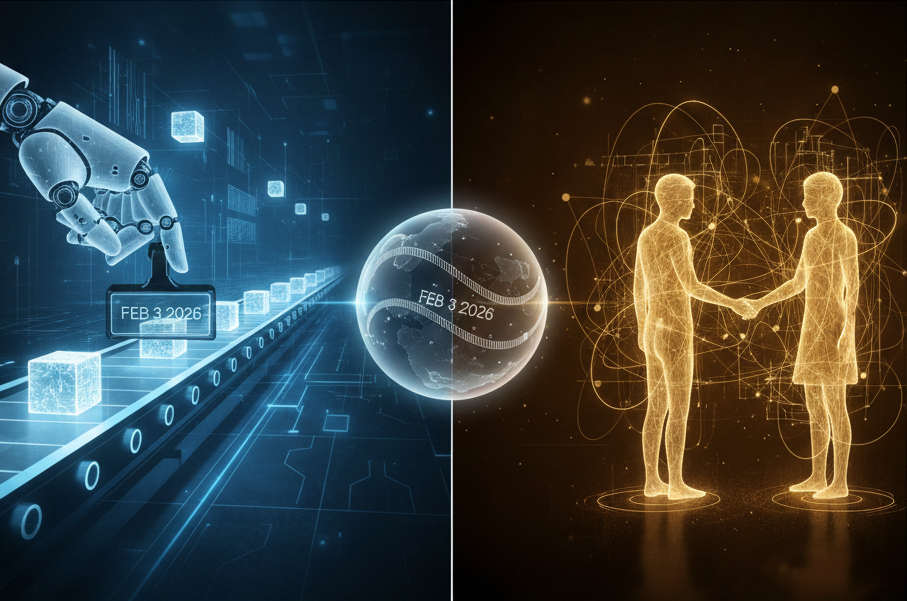
Deux approaches d’usage de l’IA en thérapie : procédure vs collaboration (et comment en tirer un vrai bénéfice)
Nous le remarquons sans cesse : quand les cliniciens parlent d’« utiliser l’IA », ils décrivent en réalité deux approches très différentes, même quand ils emploient le même outil. Et la confusion se cristallise souvent autour d’un mot : automatisation. Beaucoup entendent « automatisation » et imaginent un remplacement froid de la thérapie, ou bien pensent que c’est grosso modo la même chose que la collaboration. En pratique, l’automatisation en clinique est plus simple et plus concrète que cela. Ce n’est pas « l’IA qui fait la thérapie ». C’est le clinicien qui délègue des étapes répétables du flux de travail, puis qui supervise la production comme il le ferait avec un·e assistant·e ou un·e stagiaire. En mode procédural, l’IA devient un substitut d’exécution. On demande, elle répond ; on colle, on envoie. Le résultat sert l’efficacité : textes plus rapides, formulations plus rapides, structures plus rapides. Cela peut réellement alléger la charge, surtout les jours où l’on porte plusieurs cas tout en essayant de documenter, planifier et communiquer clairement. Mais le mode procédural comporte un risque intégré : il peut court-circuiter l’étape où l’on se demande « Quelle affirmation vient d’être faite, et ai‑je réellement les données cliniques pour la soutenir ? » En thérapie, où le travail est à forts enjeux et dépend fortement du contexte, sauter cette étape n’est jamais anodin. Le mode collaboratif est différent. Ici, l’IA est traitée comme un partenaire de réflexion qui nous aide à affiner ce que nous savons déjà. Nous fournissons le contexte, les contraintes et les objectifs, et nous évaluons activement puis révisons ce qui revient. Le bénéfice n’est pas seulement la Vitesse, c’est la qualité. À mesure que les objectifs deviennent plus complexes, le travail ne disparaît pas ; il se déplace vers la formulation, la supervision et le jugement. Ce déplacement est essentiel, car il reflète ce qu’est déjà une bonne thérapie. La valeur centrale n’est pas de « faire des tâches ». La valeur centrale, c’est de choisir ce qui compte, de rester fidèle à la formulation, et de vérifier si ce que nous faisons aide réellement ce client, ici et maintenant. Avec cette clarté, la question « où l’automatisation a‑t‑elle sa place ? » devient plus simple : l’automatisation a sa place autour de la séance, pas au cœur de la relation thérapeutique. Elle soutient le travail répétitif qui épuise silencieusement les cliniciens, pour que vous arriviez avec davantage de focus et de présence. Concrètement, cela commence souvent par la gestion des courriels : proposer des brouillons pour la prise de rendez‑vous, les messages de cadrage et de limites, les premiers contacts, les suivis, ou la coordination avec les parents ou les écoles. L’IA peut vous fournir un brouillon propre très vite, mais le clinicien protège toujours le ton, la confidentialité et le cadre thérapeutique avant tout envoi. L’automatisation peut aussi soutenir les parcours d’évaluation, surtout dans leurs volets mécaniques comme la cotation et l’organisation du rapport. Elle peut aider à mettre en forme des tableaux, à structurer les sections de manière cohérente, et à rédiger des descriptions neutres un gain de temps sans prétendre « interpréter ». De même, elle peut vous aider à préparer des questions : générer des questions d’anamnèse, des invites de check‑in, ou des questions de réflexion entre les séances, adaptées à votre modèle et aux objectifs du client. Cela ne remplace pas le jugement clinique ; cela vous offre simplement un échafaudage plus clair pour recueillir l’information et suivre le changement. Autre levier à fort impact : la préparation de séance. Si vous fournissez un bref résumé non identifiant de la séance précédente, l’IA peut aider à élaborer un plan focalisé : thèmes à revisiter, hypothèses à tester, rappels de ce qui a été convenu, et pistes de questions ou d’interventions alignées sur votre orientation. L’objectif n’est pas de « scénariser la thérapie », mais de réduire la charge mentale liée au fait de reconstruire le fil pour démarrer la séance ancré. Plus sensible, mais parfois très utile, est l’usage de l’automatisation autour de l’enregistrement et de la documentation des séances (uniquement avec consentement explicite et au sein d’un système respectueux de la confidentialité). L’IA peut aider à produire des transcriptions, relever des thèmes, et proposer une trame de note ou un résumé. Cela doit toutefois rester supervisé : l’IA peut manquer une nuance, mal interpréter un sens, ou formuler trop fortement. En documentation clinique, l’exactitude et la responsabilité priment sur la vitesse ; le clinicien vérifie donc toujours ce qui est écrit, en particulier concernant le risque, les plans de sécurité, et toute affirmation diagnostique ou médicale. Enfin, l’automatisation peut soutenir ce que beaucoup de cliniciens souhaitent faire mais peinent à maintenir régulièrement : comparer les progrès dans le temps. Qu’il s’agisse de mesures d’issue, d’évaluations de séance, d’objectifs, de suivi des tâches entre les séances, ou de repères narratifs, l’IA peut aider à résumer les évolutions depuis la ligne de base, repérer des motifs au fil des séances, et proposer un court bilan « ce qui s’améliore / ce qui coince / ce qu’on ajuste ensuite ». L’outil organise et met en évidence les tendances ; vous décidez de ce qu’elles signifient et de la prochaine étape clinique. Tout cela ne fonctionne que si nous restons vigilants sur les données et la confidentialité. Nous évitons d’entrer des informations identifiantes, sauf dans un système approuvé et conforme à la protection de la vie privée. Nous ne traitons pas la sortie de l’IA comme une verité, en particulier pour le diagnostic, l’évaluation du risque, les sujets liés à la médication, ou toute assertion médicale. Et nous gardons le rôle du clinicien explicite : l’IA peut générer du langage, des options et de la structure, mais nous apportons le jugement, l’éthique et la responsabilité. C’est aussi pourquoi de nombreux cliniciens sont attirés par l’idée de faire tourner un modèle génératif privé en local sur leur ordinateur, hors ligne, afin que les données ne quittent pas l’appareil. Même dans ce cas,