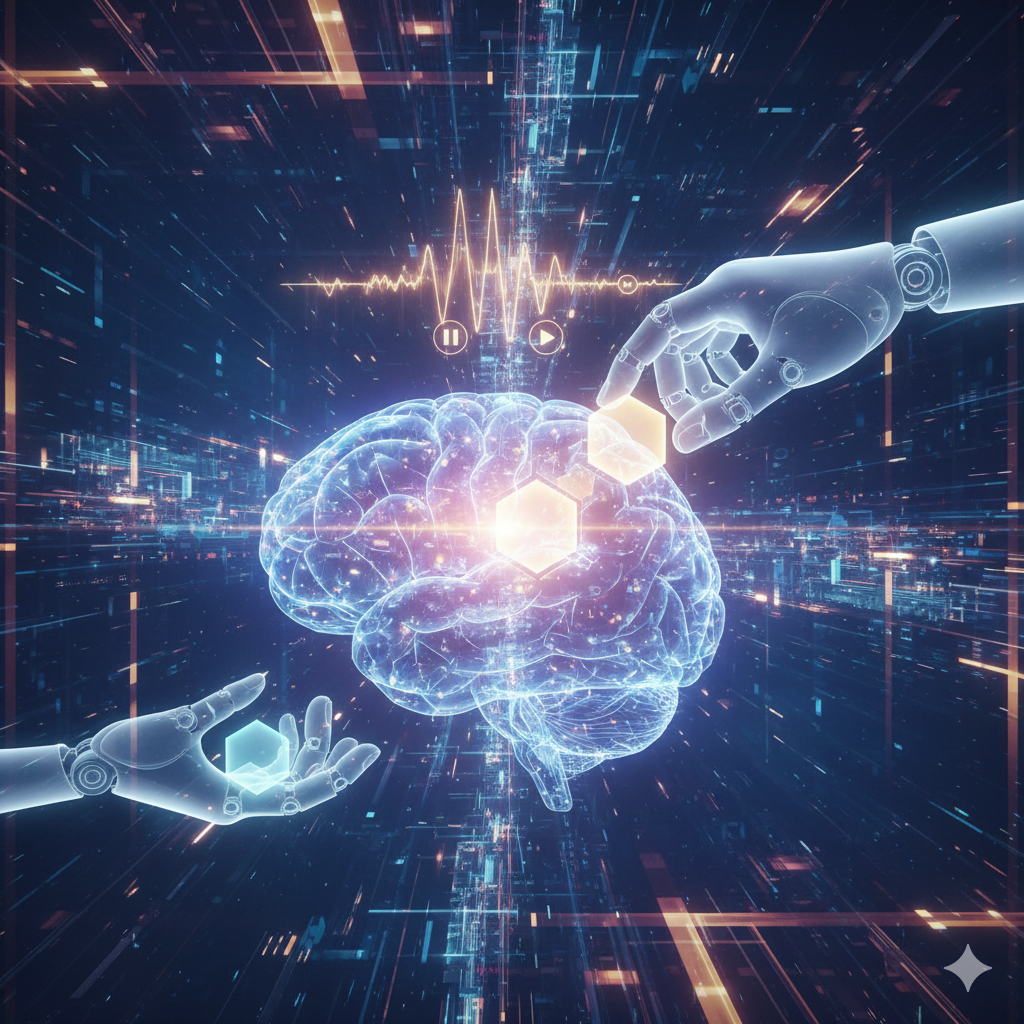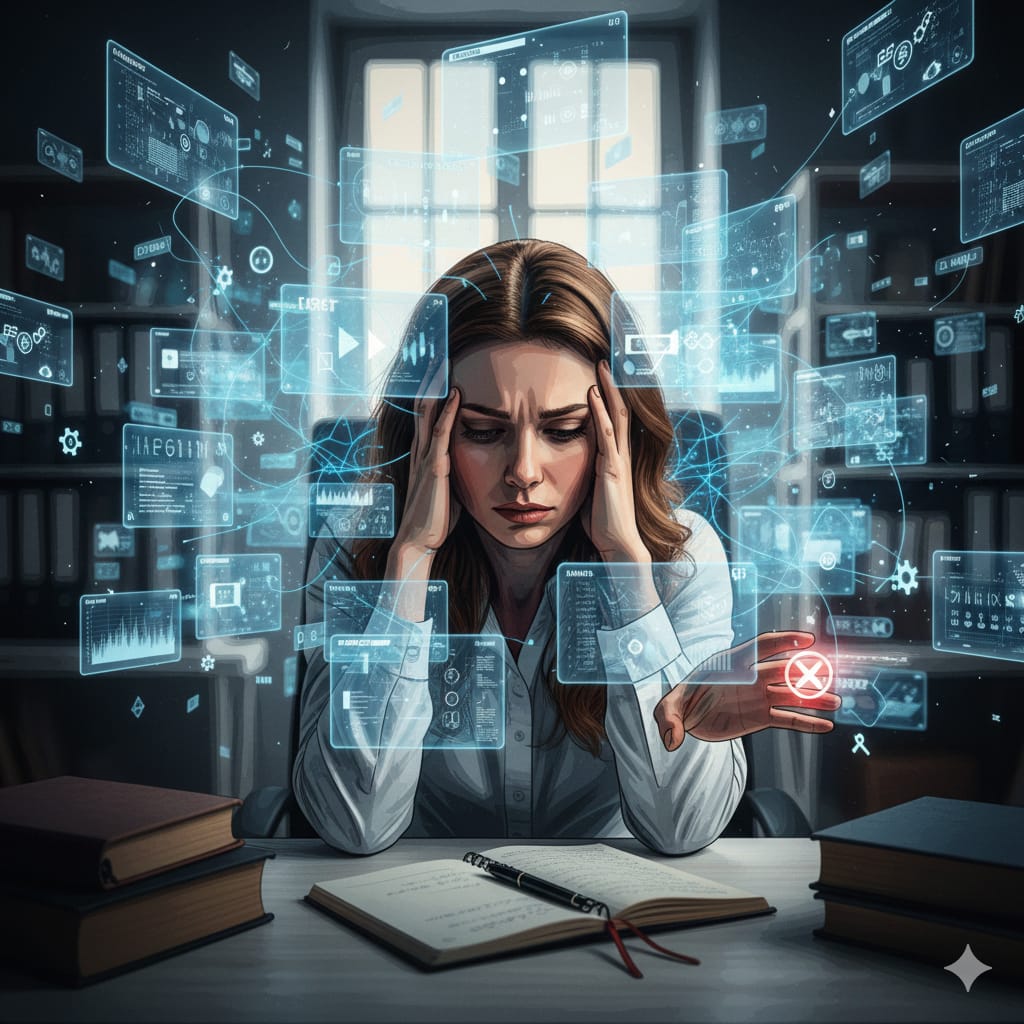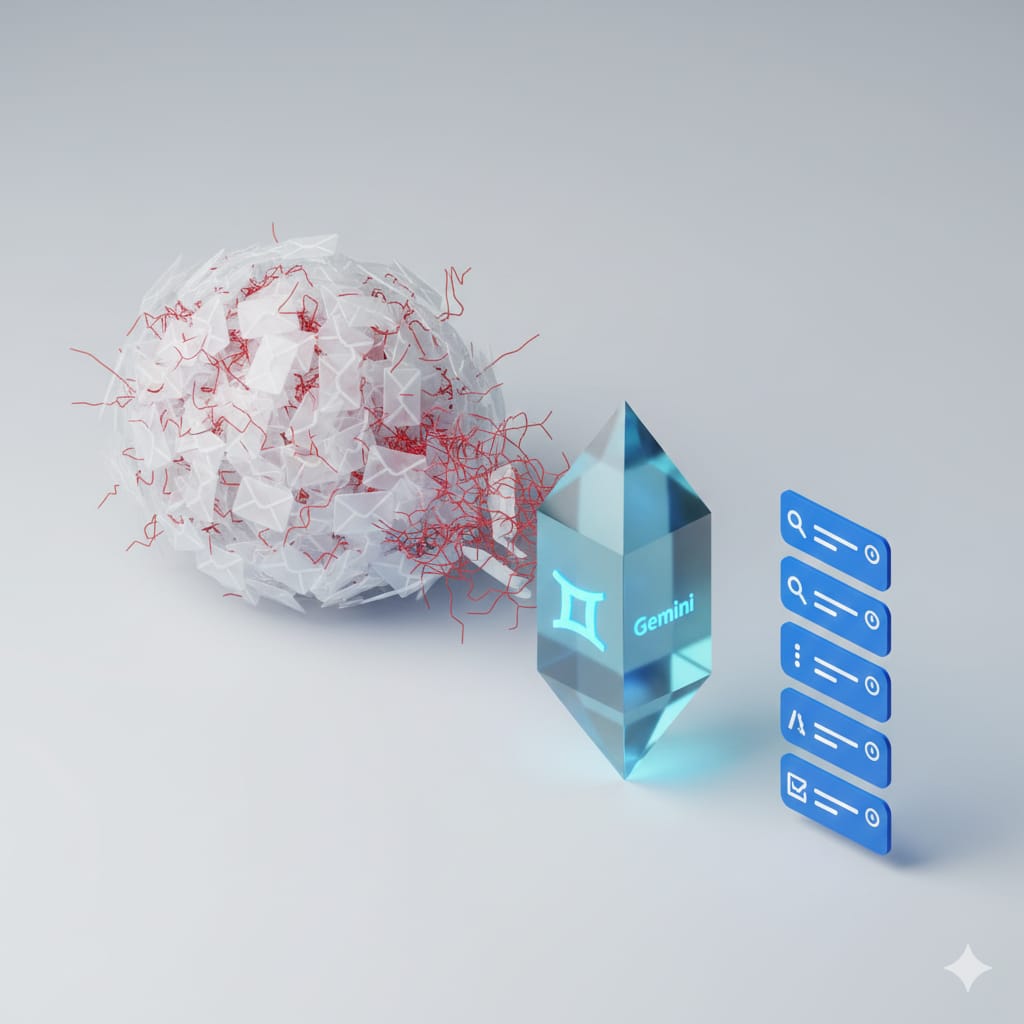Guided Learning par Google Gemini. Quand la technologie commence à ressembler à un bon enseignement
En tant que cliniciens, nous enseignons rarement comme les manuels. Nous ne « livrons » pas l’information en une longue explication en espérant qu’elle atteigne sa cible. Nous ralentissons. Nous vérifions la compréhension. Nous ajustons le langage, les exemples, le rythme. Nous mettons en place un étayage. Dans la vraie vie, l’apprentissage est guidé. C’est pourquoi la nouvelle fonctionnalité de Google Gemini, Guided Learning, a retenu notre attention. Pas parce qu’il s’agit d’intelligence artificielle, mais parce que le modèle d’apprentissage qui la sous‑tend nous est familier. Guided Learning permet aux utilisateurs d’explorer n’importe quel sujet étape par étape, comme avec un tuteur disponible et réactif. Au lieu de submerger l’apprenant d’informations, elle construit la compréhension de manière graduelle et intentionnelle. D’un point de vue clinique, cela compte. Nous constatons chaque jour que les difficultés d’apprentissage relèvent rarement d’un manque de capacités. Elles tiennent à la surcharge, à un séquençage inadéquat et à un mode de transmission inadapté. Beaucoup d’apprenants se désengagent non pas parce que le contenu est trop complexe, mais parce qu’il arrive trop vite, de façon trop dense, ou sans soutien suffisant. Guided Learning répond à cela en modifiant la manière dont l’information est délivrée, et non ce qui est enseigné. Plutôt que de présenter d’emblée une explication complète, Gemini introduit les concepts par étapes. Il s’arrête pour vérifier la compréhension avant d’avancer. Si l’apprenant éprouve des difficultés, il reformule ou ralentit. S’il montre de l’aisance, il progresse. Cela reflète notre façon de travailler en séance, que nous soutenions le développement du langage, les fonctions exécutives, la compréhension émotionnelle ou les compétences académiques. Ce qui nous a également frappés, c’est le rôle actif de l’apprenant. Guided Learning ne positionne pas l’utilisateur comme un consommateur passif d’informations. Elle pose des questions, encourage la réflexion et s’appuie sur les réponses. Cela s’aligne fortement avec les données de la psychologie de l’éducation selon lesquelles l’engagement actif et la récupération en mémoire sont essentiels à un apprentissage significatif et à la rétention. Pour nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes avec lesquels nous travaillons, la charge cognitive constitue un obstacle majeur. Les plateformes d’apprentissage traditionnelles supposent souvent que « plus d’informations » signifie « mieux ». Guided Learning adopte l’approche inverse. Elle privilégie la structure, le rythme et la profondeur plutôt que le volume. Ce changement, à lui seul, peut transformer l’expérience d’apprentissage. Du point de vue du langage et de la communication, c’est particulièrement pertinent. Un langage dense, des explications abstraites et un contexte limité sont des raisons fréquentes de désengagement. Une approche guidée et adaptative permet une exposition graduelle, de la répétition et de la clarification. C’est essentiel pour les apprenants avec un trouble développemental du langage, une dyslexie, un TDAH ou des besoins d’apprentissage en langue seconde. Il existe aussi une dimension émotionnelle qui mérite l’attention. Les expériences répétées de confusion et d’échec façonnent l’estime de soi des apprenants. Lorsque l’apprentissage est soutenu et prévisible, la confiance grandit. Guided Learning réduit le sentiment d’être perdu. Elle offre une structure sans rigidité, ce à quoi nous veillons intentionnellement dans le travail clinique. Comment nous avons utilisé Guided Learning Nous avons voulu vivre Guided Learning en utilisateurs, et pas seulement en lire la description. L’accès a été agréablement simple. Nous avons ouvert Google Gemini sur le web, démarré une nouvelle conversation, puis sélectionné Guided Learning dans la liste des modes. À partir de là, nous avons soit posé une question, soit téléversé un document à étudier. Aucune configuration, aucun plugin, aucun réglage. Ce qui nous a frappés immédiatement, c’est le rythme. Gemini ne s’est pas précipité pour fournir une réponse complète. Il a introduit le sujet étape par étape, vérifié notre compréhension, et n’a avancé que lorsque cela avait du sens. Cela seul a rendu l’expérience plus intentionnelle et moins accablante. Ce qui distingue Guided Learning La force de Guided Learning réside dans la structuration de l’information. Les leçons sont conçues pour la profondeur plutôt que pour des synthèses superficielles. Les concepts sont superposés de façon réfléchie, de sorte que la compréhension se construise naturellement. Le support multimédia est également solide. Selon le sujet, les explications peuvent inclure des images, des vidéos ou des éléments interactifs. Cela reflète la manière dont nous varions les modalités en thérapie en fonction des besoins et des préférences de l’apprenant. Autre caractéristique notable : l’utilisation de courts quiz et de questions réflexives. Ils apparaissent naturellement dans le flux d’apprentissage et aident à consolider la compréhension avant de poursuivre. Cette approche s’aligne bien avec les recherches sur la pratique de récupération et la consolidation des apprentissages. Surtout, le système s’adapte. Lorsque l’apprenant démontre sa compréhension, il progresse. En cas d’incertitude, il ralentit et reformule. Cette réactivité donne à l’expérience un caractère guidé plutôt que scénarisé. Bien sûr, Guided Learning n’est pas une thérapie. Elle ne remplace pas le raisonnement clinique, la définition individualisée d’objectifs ni la relation thérapeutique. Elle ne tient pas pleinement compte des besoins de régulation sensorielle, des états émotionnels ou d’histoires développementales complexes. Il existe aussi un risque de dépendance excessive si ces outils sont utilisés sans discernement professionnel. Cela dit, en tant qu’outil de soutien, son potentiel est clair. Guided Learning peut favoriser le transfert entre les séances, en particulier pour les apprenants plus âgés et les adultes. Elle peut aider les clients à construire des connaissances de base, à renforcer des concepts introduits en thérapie ou à explorer des sujets de façon structurée. Pour les cliniciens, elle peut aussi servir de compagnon d’apprentissage pour la formation continue, permettant d’explorer de nouveaux thèmes sans surcharge cognitive. Ce qui ressort le plus La philosophie qui sous‑tend cette fonctionnalité. Guided Learning part du principe que la compréhension se construit, elle ne se « délivre » pas. Que l’apprentissage bénéficie du rythme, du feedback et de la structure. Ce ne sont pas des idées nouvelles pour les thérapeutes. Elles sont au cœur d’une intervention efficace. Sous bien des aspects, cette fonctionnalité ressemble moins à de l’intelligence artificielle qu’à un étayage numérique. Utilisée avec discernement, elle complète